Olivier Douville / Marie Bonaparte, Sigmund Freud. Correspondance intégrale 1925-1939

Texte publié sur le Blog D’Olivier Douville
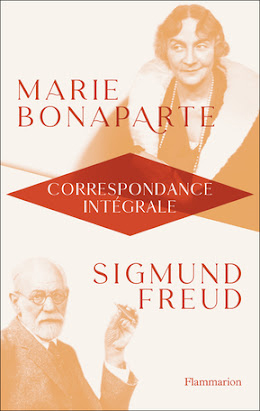 « Je suis la dernière Bonaparte, proclamait-elle volontiers. Mes cousins de la branche impériale ne sont que des Napoléon ! » Arrière-petite-nièce de l’empereur, Marie aurait pu se contenter d’être une princesse parmi tant d’autres. Descendante de Lucien, née le 2 juillet 1882, elle appartient à la branche indocile du clan. En 1870, son grand-père Pierre a déchaîné le scandale en assassinant le journaliste Victor Noir dans un accès de colère. De son union plus ou moins clandestine avec Nina Ruflin, fille d’un ouvrier fondeur, Pierre aura deux enfants, Roland et Jeanne. En 1880, Roland épouse Marie-Félix Blanc, richissime héritière du casino de Monte-Carlo. À peine la malheureuse jeune femme a-t-elle le temps de mettre au monde Marie qu’elle s’éteint, rongée par la tuberculose.
« Je suis la dernière Bonaparte, proclamait-elle volontiers. Mes cousins de la branche impériale ne sont que des Napoléon ! » Arrière-petite-nièce de l’empereur, Marie aurait pu se contenter d’être une princesse parmi tant d’autres. Descendante de Lucien, née le 2 juillet 1882, elle appartient à la branche indocile du clan. En 1870, son grand-père Pierre a déchaîné le scandale en assassinant le journaliste Victor Noir dans un accès de colère. De son union plus ou moins clandestine avec Nina Ruflin, fille d’un ouvrier fondeur, Pierre aura deux enfants, Roland et Jeanne. En 1880, Roland épouse Marie-Félix Blanc, richissime héritière du casino de Monte-Carlo. À peine la malheureuse jeune femme a-t-elle le temps de mettre au monde Marie qu’elle s’éteint, rongée par la tuberculose.
Marie Bonaparte, Sigmund Freud Correspondance intégrale. 1925-1939, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, Paris, Flammarion, 2022
 Marie Bonaparte (1882-1962), arrière-petite-nièce de Napoléon 1er, fut aussi la fille de l’anthropologue Roland Bonaparte. Venue au monde au mois de juillet 1882 par les bons soins du célèbre alors Professeur Pinard qui dut la réanimer le long de trois quarts d’heure de bouche à bouche, la voilà orpheline de mère un mois plus tard.
Marie Bonaparte (1882-1962), arrière-petite-nièce de Napoléon 1er, fut aussi la fille de l’anthropologue Roland Bonaparte. Venue au monde au mois de juillet 1882 par les bons soins du célèbre alors Professeur Pinard qui dut la réanimer le long de trois quarts d’heure de bouche à bouche, la voilà orpheline de mère un mois plus tard.
Marie passe de nounous en nounous, son père joue un rôle discret, tout occupé par sa carrière de savant pour laquelle il a abandonné sa carrière militaire. Précocement titillée et inspirée par le goût pour l’écriture, elle rédige entre 5 et 8 ans un ensemble de cahiers, ses « Bêtises », dira-t-elle, qui lui permettent de se tresser un abri en stimulant son penchant pour les constructions de sa pensée enfantine rêveuse et en tempérant les affres des mélancolies précoces. Freud prêtera intérêt à de telles primes expressions écrites.
Mariée au principe Georges 1er de Grèce et du Danemark, de douze ans son aîné et à qui l’a présenté le prince Roland, elle se rend vite compte de l’homosexualité de son époux dont elle eut pourtant deux enfants.
 La princesse connaît des aventures érotiques puis de grandes passions, dont une avec Aristide Briand. Elle s’échappe avec intrépidité de la pesanteur d’un ennui nauséeux et morbide que distille chaque jour son environnement guindé en cultivant les rencontres avec les lettrés et érudits de son temps. C’est dans ce vif besoin de fuir un monde stérile où elle étouffe qu’elle rencontre son premier mentor, Gustave Le Bon.
La princesse connaît des aventures érotiques puis de grandes passions, dont une avec Aristide Briand. Elle s’échappe avec intrépidité de la pesanteur d’un ennui nauséeux et morbide que distille chaque jour son environnement guindé en cultivant les rencontres avec les lettrés et érudits de son temps. C’est dans ce vif besoin de fuir un monde stérile où elle étouffe qu’elle rencontre son premier mentor, Gustave Le Bon.
Ardente disciple de Freud qu’elle rencontre en 1925 et qui la gardera en cure analytique bien plus longtemps qu’il ne le fit avec ses autres disciples passés sur son divan, elle est connue du grand public pour aux moins quatre raisons :
– son important travail de traductrice des textes de Freud en français (la précédèrent, cependant, I. Meyerson et de S. Jankélévitch),
– son rôle dans l’organisation de la psychanalyse en France, de la fondation de la Société Psychanalytique de Paris en 1927 à celle de l’Institut de Psychanalyse de Paris en 1934, qu’elle finança amplement et dot elle prit la direction,
– ses infatigables prodigalités de mécène dont bénéficia grandement le mouvement psychanalytique et ses publications (dont le Verlag),
 – le fait qu’avec W. Bullit, ambassadeur américain de Roosevelt à Paris, elle a aidé Freud à quitter Vienne pour Londres avec une partie de sa famille en participant au paiement aux nazis de la somme très importante qu’ils exigeaient des juifs.
– le fait qu’avec W. Bullit, ambassadeur américain de Roosevelt à Paris, elle a aidé Freud à quitter Vienne pour Londres avec une partie de sa famille en participant au paiement aux nazis de la somme très importante qu’ils exigeaient des juifs.
De tels titres de gloire, à l’évidence colossaux, nous feraient oublier l’œuvre écrite. Il est vrai que l’œuvre publiée de Marie Bonaparte reste difficilement disponible, pour ne rien dire de ses récits en prose sous forme de contes (Le printemps sur mon jardin, Flammarion, 1924).
Pour ce qu’il en est des textes théoriques, on citera ici ses tentatives sociologiques menées avant la rencontre avec Freud sous la houlette du sociologue Le Bon et qui donnèrent le livre Guerres militaires et guerres sociales, paru en 1920 chez Flammarion, que prolongera Mythes de guerre (Imago Pub., 1947). N’oublions pas une étude assez dépassée, longue exploration psychobiographique d’E. Poe qu’en 1933 publia Denoël et ces deux ouvrages parus en 1952 reliant la psychanalyse à l’anthropologie et à la biologie ainsi que son autobiographie À la mémoire des disparus, parue en 1958 aux Puf dans une relative indifférence du monde psychanalytique.
 Un de ses livres les plus engagés théoriquement mais comme dépassé alors est De la sexualité de la femme (Puf, 1951). S’y rencontrent encore des échos d’un de ses articles des plus insolites, paru sous le pseudonyme de Narjani [1], en avril 1924 dans les colonnes du n° 4 de Bruxelles médical où la sexologie se mêle à la chirurgie sous l’influence de Le Bon et qui sembla rapidement extravagant aux psychanalystes femmes, dont J. Lampl de Groot. Pour Marie Bonaparte, la frigidité serait liée à une malformation anatomique, toutes deux acceptant que la mesure de la distance méato-clitoridiennne soit un moyen d’évaluer la frigidité. Même impliquée de vive façon dans le mouvement analytique et dans les vifs débats qui s’y donnent cours concernant la sexualité féminine, elle maintient cette fable organique et se fera opéra trois fois de 1926 (un an après sa rencontre avec Freud) à 1931, alors qu’elle est en cure avec Freud. Aussi étonnant que cela puisse nous paraître, les travaux de Narjani reçurent un accueil favorablement impressionné par le gynécologue américain R. Dickinson en 1930 et par le psychologue C. Landis dix années plus tard. Elle critiquera ce texte, le qualifiant de « para analytique » dans l’ouvrage paru en 1951 aux PUF .
Un de ses livres les plus engagés théoriquement mais comme dépassé alors est De la sexualité de la femme (Puf, 1951). S’y rencontrent encore des échos d’un de ses articles des plus insolites, paru sous le pseudonyme de Narjani [1], en avril 1924 dans les colonnes du n° 4 de Bruxelles médical où la sexologie se mêle à la chirurgie sous l’influence de Le Bon et qui sembla rapidement extravagant aux psychanalystes femmes, dont J. Lampl de Groot. Pour Marie Bonaparte, la frigidité serait liée à une malformation anatomique, toutes deux acceptant que la mesure de la distance méato-clitoridiennne soit un moyen d’évaluer la frigidité. Même impliquée de vive façon dans le mouvement analytique et dans les vifs débats qui s’y donnent cours concernant la sexualité féminine, elle maintient cette fable organique et se fera opéra trois fois de 1926 (un an après sa rencontre avec Freud) à 1931, alors qu’elle est en cure avec Freud. Aussi étonnant que cela puisse nous paraître, les travaux de Narjani reçurent un accueil favorablement impressionné par le gynécologue américain R. Dickinson en 1930 et par le psychologue C. Landis dix années plus tard. Elle critiquera ce texte, le qualifiant de « para analytique » dans l’ouvrage paru en 1951 aux PUF .
Passionnée par le crime et résolument hostile à la peine de mort, elle entreprit, ce qui semble être son travail psychanalytique le plus cohérent, l’étude de madame Lefebvre, meurtrière de sa belle-fille enceinte. Elle en publia, en 1926, les résultats après une patiente et minutieuse étude du dossier et ayant conduit plus de quatre heures d’entretien avec la meurtrière. Elle déplia, pour rendre compte des motifs obscurs du crime, les principaux ressorts de la théorie du complexe œdipien. On le voit, les curiosités de la Princesse sont très riches et très nombreuses, au nombre desquelles on compte encore l’anthropologie ; elle aimera Malinowski et un peu Griaule et, qui s’en étonnerait, trouvera de l’intérêt à piocher assidument les mornes études voyeuristes commises par le lépidoptérologue et ethnologue Felix Bryk, auteur de Voodoo-Eros. Ethnological Studies in the Sex Life of the Africans Aborigenes,(New York, 1933) livre inepte dont elle attend beaucoup et dont elle ne tirera rien.
L’épais volume de la correspondance essentiellement écrite en allemand[2] avec Freud intéresse et émeut encore aujourd’hui. Les confidences abondent. Freud est attentif et protecteur. Il sait qu’il peut compter sur la farouche énergie dont fait montre la Princesse pour secouer ses collègues français, contrôler les traductions, presser le tempo des rencontres et organiser le mouvement. La fière autorité de la princesse rassure le psychanalyste soucieux que le rayonnement de la psychanalyse puisse dissuader les critiques les plus pernicieuses – quoiqu’il ne nourrisse pas à ce propos de grandes espérances – et désireux que ses thèses gagnent un public chez les artistes et praticiens des sciences affines. À cet égard, la correspondance contient un ensemble d’informations importantes concernant le rôle institutionnel que la princesse se donne, occupe, impose et vit comme une mission. On gagnerait toutefois à lire aussi, comme complément sans doute plus précis encore sur l’organisation de la psychanalyse en France du temps de Freud, les lettres nombreuses qu’échangèrent Laforgue et Bonaparte[3].
Et c’est sans doute autre chose encore qui donne à cette correspondance volumineuse entre la princesse psychanalyste et Freud, soit un parfum de connivence, une chaude ambiance d’amitié. Freud que nous lisons comme un prince de l’humour et de l’ironie avec d’autres psychanalystes (je pense ici à ses échanges parfois rosses avec Eitingon) se montre chaleureux, acceptant l’échange. C’est aussi un dialogue des corps, dans lequel celui tant opéré de Marie Bonaparte rencontre la mâchoire martyre de Freud.
Au Freud paternel, paternaliste souvent, Marie Bonaparte s’adresse avec dévotion, puis dans une écriture fine, acérée, elle joue avec l’autorité de Freud et se confronte à lui avec joie, et confiance, toute résolue aussi dans la lutte farouche et opiniâtre qu’elle mène contre son propre corps.
Les heures sombres se profilent, les jours terribles arrivent. Marie Bonaparte tente de convaincre Freud.
Elle le sauvera.
Bien sûr, cet ensemble de missives nous plonge au vif de l’histoire de notre discipline, ce dont nous avons un bien vif besoin. Mais ce livre apporte plus encore, il jette une lumière insistante sur notre histoire européenne, la décrépitude de ses empires, le somnambulisme intellectuel et politique d’après la première guerre qui gagna aussi bien des psychanalystes – faut-il ici redire les conditions de la chute de l’Institut de Berlin ?

Tout au long de ces beaux et longs échanges, graduellement se dessine puis s’affirme le portrait d’une femme libre, courageuse, fière, refusant le destin de figurine décorative d’une dynastie en perdition.
Après Freud, Marie Bonaparte écrivit (cf. supra), batailla contre Lacan et manifesta – ce qui est moins connu – une allergie constante contre les thèses de la psychosomatique défendues par Pierre Marty en 1950. Militant sans relâche en faveur de la psychanalyse laïque et sans concession aucune pour qui voulait encore réserver l’exercice de la psychanalyse aux médecins, on la vit défendre avec son ardeur légendaire la psychanalyste Margaret Clark-Williams poursuivie par l’Ordre des médecins pour exercice illégal de la médecine. Nous étions au début des années 1950. Elle en fit de même, et ce fut tout aussi en vain, pour Elsa Bauer.
On doit à Rémy Amouroux, également biographe de la princesse[4], l’édition de ces lettres soigneusement annotées. Et je salue également la performance éditoriale. Correspondance à lire donc pour chaque psychanalyste soucieux de se situer dans son histoire.
[1] Pseudonyme qui se réfère au sanscrit : « nar » pour homme, « jani » pour femme.
[2] La traduction est d’Olivier Mannoni.
[3] On se reportera à Jean-Pierre Bourgeron : Marie Bonaparte et la psychanalyse à travers ses lettres à René Laforgue et les images de son temps, Genève, Slatkine, 1993 ; également à Célia Bertin, Marie Bonaparte, Paris, Perrin, 2010 (préface d’É. Roudinesco)
[4] R. Amouroux, Marie Bonaparte, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012

