Daniel Cassini / Les illuminècheunes
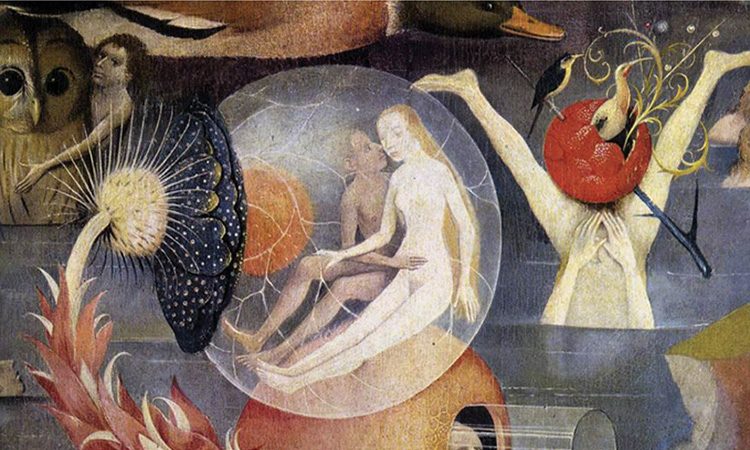
Texte paru dans les actes du séminaire de l’AEFL 2012-2013
Bien que nos renseignements soient faux nous ne les garantissons pas.
E. Satie
Illuminècheunes, écrit Verlaine dans une lettre à Charles de Sivry datée de 1878. « Illuminations », Rimbaud. « Illuminations », cet ensemble terminal de poèmes en prose rimbaldiens, est un terme d’origine anglaise, proche du sens d’enluminures : « painted plates », « coloured plates ». Il n’a rien à voir, comme on pourrait censément le penser, avec les illuminations, soit l’inspiration subite du poète qui s’était fait voyant par un « long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens ». Il y a du réel dans ces illuminations, pas de l’ineffable. N’oublions cependant pas, pour être juste, ce que Rimbaud répond à sa mère à propos du manuscrit « D’une saison en enfer » : « J’ai voulu dire ce que cela dit, littéralement et dans tous les sens. » Ce qui amène à ne négliger aucune interprétation, aucune équivoque.
« Interruption de la mauvaise continuité de l’histoire », telle est la définition que Walter Benjamin donne de la révolution. À l’occasion de cette communication dans le cadre de l’AEFL, je m’autorise à détourner cette phrase, remarquable par sa concision, de l’exilé allemand en lui ajoutant un simple vocable, fidèle en cela que je suis à ce conseil prodigué par Isidore Ducasse dans Poésies 2. « Une maxime, pour être bien faite, ne demande pas à être corrigée. Elle demande à être développée. »
« Interruption de la mauvaise continuité de l’histoire d’un sujet », telle peut être alors la définition de la révolution psychanalytique. Irruption de la coupure signifiante, du désir, de l’inconscient, du réel dans la morne plaine, morne plainte de la répétition, du même, du mortifère… Advenue dans la cure de ce que Heidegger, dans son Séminaire sur Schelling de l’été I936 appelle « paroles essentielles » : « Ces actions qui se produisent en ces instants décisifs où l’éclair d’une illumination splendide traverse la totalité du monde. »
Dans un livre publié en 1992 et appelé « Transmission de la psychanalyse », notre collègue et ami Stoïan Stoïanoff, avance un certain nombre de propositions surprenantes d’où leur intérêt, en tout cas le mien. Stoïan évoque tout d’abord le secret de l’accession à la « bouddhéité » et la qualification analytique. Précisant les postulats qui vont diriger sa démarche, Stoïan avance que la psychanalyse et notamment la psychanalyse freudienne (ainsi que le dispositif qu’elle préconise à cette fin) n’est qu’une voie parmi d’autres pour atteindre le nirvana.
Rappelons que si Lacan, lui, se soutenait de l’appellation de « dernier des kabbalistes chrétiens », certains n’ont pas hésité, à tort ou à raison, de le qualifier de Maître Zen, de bien d’autres qualificatifs encore… Le personnage est assez vaste pour tous les accueillir… Personnellement, j’appliquerai à Lacan ce que le grand poète victorien Gérard Manley Hopkins, inventeur du sprung rythm – rythme abrupt, rythme bondissant –écrivait à propos du docteur franciscain, surnommé le Docteur subtil, Duns Scot : « démêleur du réel le plus fin-grain, sondeur inégalé »
À cet égard, il m’a paru intéressant, désirable, fécond je l’espère, critiquable sans doute, d’aller rechercher dans l’immense corpus théorique et pratique du bouddhisme ce qui peut nous rapprocher, de près ou de loin, du thème de cette année : le réel
C’est dans ce qui est communément appelé, souvent à tort et à travers –voyez certaines publicités cool – le Zen, que j’ai effectué mes investigations en « dilettante sérieux » ; comme, différemment, nous avait confié le peintre Piero Simondo évoquant ses amis fondateurs de l’Internationale situationniste à Cosio d’Arroscia en 1957, qu’ils étaient tous, lui y compris, des « ivrognes sérieux ».
C’est plus particulièrement dans ce qui participe d’une technique singulière appelée ko-an que les bouddhistes adeptes du Zen ont trouvé avec leur génie propre « le lieu et la formule » chers à Rimbaud, l’arche du réel…
C’est en Chine au VIe siècle qu’apparaît le bouddhisme Zen ou T’chan. T’chan est la première syllabe du mot chinois Tc’han-na, zenna en japonais, le terme sanscrit étant dhyana qui signifie concentration – contemplation. C’est toujours en Chine au XIIe siècle que s’amorce l’étude du Zen par la méthode des ko-an. Celle-ci devient un système au Japon vers le XVe siècle notamment pour les adeptes de la secte Rinzaï. Le terme secte n’étant alors entaché d’aucune suspicion totalitaire, perverse, scientologue ou autre comme c’est aujourd’hui le cas… où une secte s’adresse à tous ceux qui ne se passent pas d’un Maître à condition… qu’il se serve d’eux.
Ko-an signifie littéralement « document public », « jugement faisant autorité », « principe de gouvernement ». Ko – gouvernement, an – loi, règle. Pour ce qui nous intéresse ici, ce terme désigne une question formulée par un professeur dans le but d’ouvrir l’esprit à la vérité du Zen. On compte environ 1700 ko-an, 500 environ utilisés au Japon ; chacun étant strictement adapté à la personnalité de l’élève qui le reçoit et auquel il doit vaille que vaille se mesurer, mieux, se démesurer… Le ko-an est donc une sorte de problème insoluble – si ce n’est dans le réel – que le maître donne à travailler à ses disciples. Il s’agit de tirer le ko-an de l’inconscient, de l’amener dans le champ de la conscience et par là le résoudre – tâche impossible si on l’aborde par le versant d’une stricte rationalité.
Le ko-an prend le plus souvent la forme d’une absurdité totale ou paradoxale. Pour le grand spécialiste du Zen Daisetz Teitaro Suzuki : « La méthode du Zen et du ko-an consiste à placer l’individu devant un dilemme dont il doit s’efforcer de sortir ; non à travers la logique, mais à travers un ordre de pensée plus élevé. »
Les ko-an, glissés par les maîtres comme des peaux de bananes sous les sandales des moines novices, sont ainsi des énoncés de pensées paradoxales dans le but de procurer un choc psychologique à leurs élèves, de les extraire de l’équivoque où ils s’enlisent en confondant les mots et les idées avec la réalité.
On qualifie cette expérience unique du terme de satori, éveil, illumination. Le ko-an vise l’abandon de la volonté moïque et de sa prégnance, cherchant en toutes circonstances et de toutes ses forces à saisir, maîtriser, agripper. Gardez-vous de comprendre le ko-an ! L’appréhension intellectuelle du ko-an ne produirait aucune transformation chez le disciple – un pétard mouillé, un mot d’esprit réchauffé, mort. Seule une prise de conscience expérimentale du réel peut l’y amener. On peut évoquer ici et dans le champ qui nous intéresse, le discours universitaire qui n’est jamais en reste de savoir et le discours de l’analyste riche de son non-savoir et qui offre parfois, une mutation décisive, bouleversante chez l’analysant, sur son économie psychique, sur sa jouissance, son désir, son amour, nouvel amour – le « seul qui ait des conséquences » pour Lacan.
Avec le Zen et le ko-an on se trouve situé dans ce que l’on peut appeler d’un terme vaste la logique des Orientaux. Celle-ci, logique paradoxale, s’oppose à la logique aristotélicienne. Cette dernière logique, pour faire simple, est basée sur la loi de l’identité qui établit que A est A et la loi de la contradiction, à savoir que ce qui est A n’est pas non A et la loi du moyen terme conclu : À ne peut être A et non A, ni A ou non A. Aristote soutient qu’il est impossible pour la même chose et en même temps d’appartenir et de ne pas appartenir à la même chose et dans le même rapport. « Ceci, est le plus évident de tous les principes », conclut le philosophe Grec. Ce à quoi Edmond Jabès se plaît à rappeler contre le trop de certitude dont la plupart des parlêtres sont pétris, qu’au cœur de l’évidence – allez y voir ! – il y a le vide – nécessité salubre de ménager en toutes choses un principe d’incertitude.
À l’encontre de la logique aristotélicienne nous trouvons la logique paradoxale qui établit que A et non A ne s’excluent pas l’un l’autre en tant que prédicats de X. Cette logique paradoxale est prédominante dans la pensée chinoise, et indienne – chez Héraclite également…
Lao-Tseu pose les principes de cette logique : « Les mots qui semblent la vérité sont paradoxaux » et Tchouang-Tseu d’enfoncer le clou : « Ce qui est un est un. Ce qui n’est pas un, est aussi un. » L’inconscient est le site de cette logique paradoxale. Ainsi, par exemple, le concept d’ambivalence freudien qui affirme que, pour une même personne et au même moment, on peut éprouver de l’amour et de la haine. Cette expérience – hainamoration pour Lacan – est fondée du point de vue de la logique paradoxale, elle n’a aucun sens, elle est intenable selon le point de vue d’Aristote où il apparaît comme dépourvu de sens que l’on puisse éprouver des sentiments contradictoires au même moment et pour la même personne. Allez donc demander aux obsessionnels, à « l’Homme aux rats », tiens !, ce qu’ils n’en pensent pas. Désolé, celui-ci ne peut pas vous répondre, il est occupé à enlever une pierre de la route où doit passer dans quelques heures la voiture de son amie et… à la remettre.
Entrons maintenant et rapidement dans le vif du sujet… Les ko-an affectent plusieurs formes. Énigmatiques tout d’abord, surprenantes dans tous les cas. Ainsi le maître Zen qui déclare à son élève « Si vous avez un bâton je vous en donnerai un. Si vous n’en avez pas je vous l’ôterai ».
Ha-Kuin, grand maître Zen du japon moderne avait l’habitude – habitude toujours neuve – de lever une main devant ses disciples en demandant : « Faites-moi entendre le son d’une seule main ». Les ko-an prennent de la sorte la forme de demandes impossibles : « Usez de l’épée que vous avez dans vos mains vides », « Pendant que vous chevauchez un âne, marchez à pied », « Arrêtez cette averse », « Ce bâton n’est pas un bâton et pourtant c’est un bâton. »
Le 6e patriarche, Hui – Neng demandait qu’on lui « montrât le visage qui était le vôtre avant votre naissance lorsque votre esprit ne se réfère pas au dualisme du bien et du mal. » Pour le Zen, le ko-an se trouve là où réside la vérité qui vous rendra libre, c’est, je cite, « la boule de feu dans la bouche qu’on ne peut ni avaler ni recracher ». Il s’agit avec cette méthode d’aiguillonner le disciple, de l’acculer, le mener dans une impasse dans laquelle toute échappatoire intellectuelle est impossible, interdite et vaine car elle ne fait que renforcer la sujétion de l’élève, nourrir son symptôme en somme, qui est de vouloir atteindre un savoir assuré, stable, rassurant et gratifiant. Le ko-an est un moyen habile, destiné à détruire l’habitude de conceptualisation et il s’applique chaque fois à un cas particulier comme différemment le fait une interprétation analytique qui, telle le lion, est censée ne bondir qu’une fois, sous peine d’être lettre morte, coup d’épée dans l’eau. Comme l’interprétation juste qui éteint le symptôme, le souffle, la résolution du ko-an n’aura pas nécessairement lieu, ce qui lui conférerait une garantie, une possibilité à venir, elle aura eu lieu ou pas.
Dans sa radicalité le ko-an vise à une annihilation temporaire du sujet – qu ’ il aura amené ou pas au satori – là où la recherche et la soumission désespérée à la tyrannie du sens ne font que refléter la dimension prévalente de l’imaginaire, de l’illusion, qui barre l’accès du réel.
La fourberie du ko-an consiste à conduire le disciple dans un cercle vicieux, un cul-de-sac logique. Là où l’élève veut expliquer, résoudre, maîtriser, saisir, il est assuré de manquer l’essentiel et plus il manque l’essentiel plus il veut expliquer, résoudre, etc. On peut retrouver là, la distinction que fait Freud entre le via di porre – accumuler, ajouter, rajouter une couche, celle de la suggestion notamment – et le via di levare de la méthode analytique, sa dénudation. « Créer c’est enlever », déclare pour sa part le metteur en scène Roméo Castellucci.
Le penseur Clément Rosset, évoque-lui – et son réel n’est certes pas celui de Lacan, ni celui des bouddhistes, mais quand même – « une philosophie du réel qui voit dans le quotidien et le banal, voire dans la répétition même, toute l’originalité du monde ». « Bref, ajoute – t – il, ne cherchez pas le réel ailleurs qu’ici et maintenant car il est ici et maintenant, seulement ici et maintenant ». Que dit d’autre le poète américain Cummings en quatre vers qu’aurait pu écrire un poète oriental bouddhiste ou taoïste : « Seeker of truth – follow no path – all paths lead where – truth is here ». « À chercher le vrai ne suis aucune voie, les voies mènent où, le vrai est là ».
Bien avant le célèbre « discours sans parole » de Lacan, une sentence Zen déclare : « Le sans parole est la vraie parole » ; une autre : « Parlez sans user de votre langue. »
La gestuelle utilisée par un patriarche Zen vise là aussi à ce que l’élève puisse parvenir au satori. Ainsi un maître décoche un coup de pied dans la poitrine d’un moine dont l’unique faute a été de demander : « Que signifie Boddhidharma arriva en Chine venant de l’ouest ? ». Un élève, est – il rapporté, fut submergé de joie – une joie sans cause, sans raison, sans sens, la véritable force majeure – qui dit : « Comment le coup de pied du maître dans la poitrine est – il capable d’opérer un miracle aussi transcendantal ? ».
Un autre disciple fut jeté à terre pour avoir interrogé le maître dont il suivait l’enseignement sur la vérité du Zen. Un autre encore reçut un coup de bâton, qui voulait connaître les principes premiers du bouddhisme ; un jeune moine reçut, lui, une claque sur l’oreille, pour avoir interrogé son enseignant sur le sens de la venue de Boddhidharma en Chine ; un autre, un coup de pantoufle que le maître enleva et asséna à son élève qui s’accrochait désespérément à la folie du sens et arc-bouté sur cette voie sans issue refusait d’abdiquer.
Le maître Toku-San avant même que le moine venu le consulter ait ouvert la bouche pour le questionner disait : « Trente coups de bâton si vous avez quelque chose à dire et trente coups de bâton si vous n’avez rien à dire. »
Plus proche de nous, Jean Allouch rapporte une histoire concernant une fin d’analyse avec Jacques Lacan. La séance se passe dans la dernière période de la pratique analytique de Lacan, nous sommes dans son moment de conclure, thème déjà abordé par l’AEFL il y a quelques années…
Monsieur, je n’ai plus aucune raison de venir ici.
– Dans ce cas ne venez plus.
– C’est dur de vous quitter !
– Dans ce cas revenez demain !
– Non, pas demain !
C’est alors, qu’inattendue, paf ! Une claque tint lieu d’ultime réplique.
Une dernière technique employée par les maîtres Zen du Japon se trouve exprimée par l’attitude d’un grand enseignant de la dynastie Tang au VIIIe siècle Josho-Jushin. « Un chien a-t-il la nature de Bouddha », demanda un élève appliqué ; comme il en est de certains analysants modèles massivement identifiés au symbolique, jouissant du déchiffrage du mi-dire de la vérité menteuse – « découvrir la vérité en flagrant délit d’adultère » clame le dadaïste Clément Pansaers – et accordant une préférence à l’inconscient par-dessus tout, inconscient que Lacan qualifie de « savoir emmerdant ».
– Mu, répondit le maître à son questionneur.
Mu, littéralement, signifie, non ou rien.
Tous les commentateurs s’accordent à dire – le sens du ko-an importe peu, vous l’avez compris – il fait écran, barrière – que c’est uniquement sur le son Mu, sur le signifiant dépourvu de toute signification que le disciple doit se concentrer, rien d’autre que Mu ! Mu ! Seul le réel de Mu importe ; ce qui résonne ici c’est le réel de lalangue, la motérialité de Mu, son non-sens, son ab-sens, son dé-sens.
Pareillement un maître Zen de l’école Rinzaï, était célèbre pour le son inintelligible et grommelé, « katz » qu’il proférait en réponse à toute question posée.
Pour D.T Suzuki : « L’intellect propose, mais ce n’est pas lui qui dispose. Quoiqu’on puisse en dire, l’intellect n’a qu’une importance secondaire. C’est une chose superficielle flottant à la surface de la conscience. Cette surface doit être traversée si on veut atteindre l’inconscient. »
Pour le Zen, comme d’une autre façon, pour la psychanalyse, il s’agit d’arriver à une appréhension directe, instantanée, irréfléchie du réel, sans contamination affective, moïque, sans duperie de l’ego ». « Dissoudre les mirages de l’imaginaire », déclare Lacan dans « le Discours de Rome » ; provoquer, développe Victor Braunstein en une métaphore originale, un syndrome d’immuno – déficience du moi, à travers une interprétation qui fasse résonne le réel de lalangue et le sens dont est gorgé le langage.
« La grande sagesse est comme la stupidité
La grande éloquence est comme le bégaiement
Lorsque j’entends, je vois
Lorsque je vois, j’entends », nous disent, sévères rigolards, les maîtres Zen qui, à travers sentences paradoxales, coups de pied au cul, pastissons bien ajustés, aboiements, signifiants absurdes, décalés, asémantiques, nous invitent à exténuer le savoir, à nous ouvrir à un autre point de vue, à déposer le moi et ses blandices, comme différemment on dépose le regard.
« On pourrait de façon paradoxale, voire tranchante, désigner notre désir comme un non-désir de guérir », avance Lacan dans le livre XII « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse ».
Pour le compositeur américain John Cage, très influencé par la pensée de Daisetz Suzuki, tous ces ko-an du bouddhisme zen ont pour but, (je cite) « de réduire un concept que vous avez à un état de pulvérisation tel qu’il n’existe pas. »
Pour achever cette incursion en terre bouddhiste, cette remarque du même Cage dans un entretien accordé en 1981 à la revue « Tel quel » n° 90 : « Je me souviens d’un moine illuminé qui disait : maintenant que je suis illuminé je suis aussi misérable qu’avant. »
Vous avez dit analyste ? J’ai dit illuminècheunes.
Dans « le Discours de Rome » déjà évoqué, Lacan soutient que « la psychanalyse, si elle est source de vérité l’est aussi de sagesse. Toute sagesse est un gay savoir. Elle ouvre, elle subvertit, elle doute, elle construit, elle rit. »
« Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas, cessent d’être perçus contradictoirement. Or, c’est en vain qu’on chercherait à l’activité surréaliste un autre mobile que l’espoir de détermination de ce point. »
Cette phrase célèbre d’André Breton, extraite du « Second manifeste du surréalisme » date de 1930. Elle est toujours d’actualité, toujours jouable – le terme réel devant dans cette phrase être entendu comme équivalent à réalité.
Quitte à choquer, j’entends interpeller cet auditoire en avançant ceci, d’inadmissible, comme la psychanalyse en somme… Ce point de l’esprit – rappelle-toi, l’inconscient ignore la contradiction, sa logique est paradoxale – il n’est pas impossible que tu puisses l’atteindre au cours – au long cours (ou pas, d’ailleurs) de ton analyse.
Attention ! Ne te méprends pas, rien ne garantit que tu vas l’atteindre ce point. Faut – il coûte que coûte que tu l’atteignes ce point, est – il souhaitable, exigible, valorisant, lacanien – branché, que tu l’atteignes ? Je dis et répète simplement qu’il n’est pas inconcevable que tu l’atteignes. Arrange-toi ! Tu n’es pas tout à fait sans ressources face au réel.
À cette proposition énigmatique d’André Breton fait écho par-delà le temps et l’espace cette déclaration d’un grand maître Zen Japonais : « Le Boddhisattva va mettre en branle la roue de l’identité des contradictions et oppositions : blanc et noir, sombre et lumineux, ressemblance et dissemblance, fini et infini, amour et haine, ami et ennemi, etc. »
Ce point – éclair de l’éveil, assimilable selon moi à un « bout de réel », une « guenille » de réel pour reprendre une expression de Georges Bataille dans « Madame Edwarda », il peut faire irruption dans ton analyse dans le cadre d’une séance, lors d’une interprétation, rare, certes, qui aurait un effet réel sur le réel.
Vous connaissez la formulation de Lacan : « L’effet de sens exigible du discours analytique n’est pas imaginaire. Il n’est pas non plus symbolique. Il faut qu’il soit réel. Ce dont je m’occupe c’est de penser quel peut être le réel d’un effet de sens. »
Ce peut être, justement, à travers le vacillement du fantasme où se constitue pour chaque parlêtre sa fenêtre sur le réel, abolition du moi et de ses limites. Nous sommes là, il est vrai, proche d’un symptôme psychotique, avec un nouage direct du symbolique et de l’abîme du réel qui fait chuter l’imaginaire et toute identification narcissique. Épreuve, éprouve de l’inexistence de l’Autre, de son absence, d’un sans garanti. Cette expérience, appelons là « épiphanique » en hommage à James Joyce, proche de la schizophrénie, de la mystique aussi bien, il convient de préciser qu’elle est nécessairement limitée dans le temps. Il n’y a pas, Lacan l’a bien précisé, d’accès continu au réel. On y accède par éclair, ouverture, fulgurance – retombée, fermeture, obscurité à nouveau. Mais elle aura eu lieu, un franchissement aura eu lieu, un élargissement, une ex-cursion (de excurrere – courir hors de), l’avènement du sujet mis à nu par son abolition même. Fin de partie, fin de parcours. Désidentification du sujet, mise à jour de l’objet de jouissance qui le commande, le drive, destitution subjective où l’analysant reconnaît les moyens symboliques et imaginaires qui lui ont permis de constituer une structure langagière autour de ce point – trou réel.
*
L’enseignement de Lacan, comme l’œuvre de Joyce est une œuvre ouverte, un frayage incessant, un sillage – mais en avant. Un work in progress. Le terme convient quand on sait l’intérêt que porte Lacan à Joyce dans les dernières années de son Séminaire et que c’est à l’écrivain irlandais que l’on doit le terme « work in progress » qui désigne le « Monstre », dixit Joyce, que celui-ci rédige durant 17 ans : Finnegans Wake.
Chacun, ici, dans cet amphithéâtre, qu’il soit analyste, étudiant, lecteur assidu de Lacan, a répété jusqu’à plus soif la formule canonique selon laquelle « l’inconscient est structuré comme un langage » – qui le constitue. Mais Lacan à travers une série de remaniements successifs majeurs, en spirale, fait advenir année après année le thème d’un inconscient « élucubration de savoir », d’un inconscient réel. On voit alors émerger le dédoublement d’un réel propre au symbolique et un réel absolument hors symbolique. « Dans la nouvelle science, chaque chose vient à son tour, telle est son excellence. »
L’inconscient susceptible de déchiffrement est limité en regard de ce que Lacan appelle « lalangue » et dont il dit que : « lalangue articule des choses qui vont beaucoup plus loin que ce que l’être parlant supporte de savoir énoncé. » Cette formulation qui promeut lalangue est d’une importance capitale. Il y aurait donc un savoir de lalangue et un savoir déchiffré en langage. Le néologisme, lalangue, cette trouvaille de poids, fait entendre son homophonie avec lallation. Lallation dans laquelle le son est distinct du sens. Lalangue serait donc la langue émise avant le langage structuré syntaxiquement, la langue maternelle riche de l’intégrale des équivoques possibles, le phonème étant l’unité sonore minimale de lalangue et par là de l’inconscient.
Pour Lacan, l’inconscient – lalangue, inconscient joui, excède l’inconscient langage et lalangue n’est donc pas du symbolique mais du réel. Cet inconscient réel, hors symbolique, est celui de la substance vivante, jouissante, du corps affecté par le langage.
Là où Ferenzi disait qu’une analyse « doit mourir d ’épuisement », Lacan a dégagé plusieurs termes quant à sa fin : par l’assomption de l’être pour la mort, par la subjectivation de la castration, par la destitution subjective, enfin par l’identification au symptôme. Le symptôme étant ce qui fait tenir corps, jouissance et inconscient en suppléant à l’absence de rapport sexuel inscriptible et en étant cette modalité langagière de jouissance propre à chacun, qui le distingue de tout autre sujet et auquel il convient de rendre sa dignité.
Avec la dernière avancée tracée par Lacan on aboutit à une division de l’inconscient entre un inconscient langagier, déchiffrable, corrélé avec le fantasme et qui lui donne sens, qui peut être dit, ramassé en une phrase simple – on bat un enfant – et l’inconscient réel, hors sens, et par là disjoint de l’imaginaire. Là où le langage n’inscrit que la jouissance phallique, jouissance du bla-bla, le réel hors symbolique, absolument opaque, singulier, est celui de la substance jouissante du corps où se tissent les « premiers événements de corps » comme les appelle Lacan et le langage premier. La fin de l’analyse viserait alors pour l’analysant à opérer un changement de symptôme pour dégager son symptôme fondamental plus vivable pour le sujet et à faire l’épreuve d’un certain « bénéfice de satisfaction ». Bo, b, o, comme un symptôme ! Nœud beau minimal du parlêtre es-seulé a l’inconscient ému.
Entre la rengaine du capitalisme avancé et son marché de dupe de l’aliénation marchande et du manque à jouir généralisé, tel qu’immortalisé en son temps qui est toujours plus le nôtre, par un groupe de rock Anglais :
I can’t get no satisfaction
Cause I try and I try and I try
I can’t get no satisfaction I can’t get no
et la satisfaction inestimable – à toi de l’estimer – de fin d’analyse tu peux encore choisir.
Il y a plus de 150 ans, le jeune Karl Marx écrivait à Ruge : « Vous ne me direz pas que j’estime trop le temps présent ; et si pourtant je n’en désespère pas, ce n’est qu’en raison de sa situation désespérée qui me remplit d’espoir. » Marx et Lacan, Freud et quelques autres penseurs et créateurs sans uniforme, ont durablement inquiété leur temps et sa haine inconsciente de la singularité et du style.
Allons, le Champ Lacanien, celui du sujet divisé et de sa subversion, a encore de beaux jours et ajours devant lui – l’ajour étant cette petite ouverture qui laisse passer le jour ou… pour ce qui nous intéresse, un rayon de réel – la « tourbe inflammable de l’inconscient » pour le romancier russe Vassili Grossman.
Il peut amener, au cas par cas, au un par un, au toi pour toi, une possible sortie du discours capitaliste dans lequel le parlêtre est réduit au rôle peu gratifiant de simple porteur de marchandise ravi. Servitude volontaire ! Désirer « au commandement » ! Décervelage organisé ! Hep ! Porteur ! « Il y a donc des gens que ça embête d’être libres. », déclare Pissedoux à Pissembock dans Ubu enchaîné.
Pour ce faire, ne néglige pas de mobiliser ta capacité de dérive langagière en suivant la déboussole de ce dernier – appelons-le ainsi – ko-an, même s’il nous vient de la vieille Espagne mystique : « Pour aller où tu ne sais pas, va par où tu ne sais pas. » De quoi être désorienté, certes, mais l’inconscient est à ce prix, à ce que l’on dit…
Chemin parlant, va savoir ? Tu auras peut-être l’heur de faire l’expérience fulgurante de ce que le réel est susceptible de surmonter l’imaginaire et, le temps d’un éclair, de lui damer le pion : Interprétation, illumination, satori, poésie, « cette hésitation prolongée entre le son et le sens » selon Valery, savoir y faire avec le Vide Médian, entre parole pleine et parole vide, « point qui semble enclos dans ce qu’il enclôt », dixit Dante topologue, appelle cet événement comme tu le voudras, comme tu le vivras, comme il se manifestera, t’élargira.
Dans le chant XXXIII de la Divine Comédie, à la toute fin du voyage, le poète nous enseigne, comme six cent cinquante ans plus tard le fait Lacan avec son nœud borroméen généralisé où deux des cordes du nœud à quatre du symptôme sont mises en continuité par raboutage du symptôme et du réel : « Je crois bien que je vis la forme universelle de ce nœud, car en disant cela, je sens en moi s’élargir la jouissance. »
C’est là tout le paradis que je te souhaite, analysant, mon frère, qui n’aura de cesse cependant de garder également en mémoire ce précieux viatique Joycien : « To enter heaven, travel hell », jusqu’à pouvoir soutenir, fort de l’expérience analytique et de son réel, cette assertion tirée d’« Histoire de Juliette » : « Tout est paradis dans cet enfer ».
Illuminècheunes, invente Verlaine, splendide idiot de village qui savait, « littéralement et dans tous les sens », faire résonner, entre harmonie et cloaque, « les goûts de la langue ».

